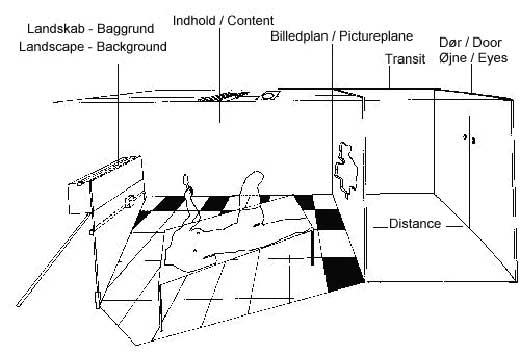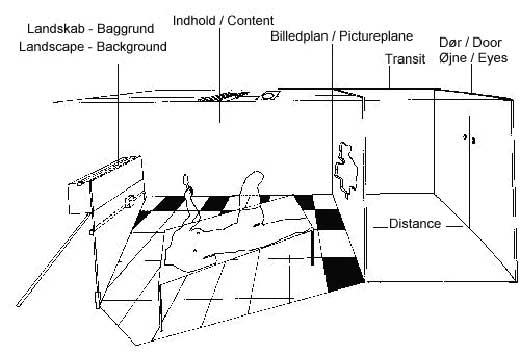
1
Le capitalisme bureaucratique a trouvé en Marx sa justification légitime. Il ne s’agit pas ici d’accorder au marxisme orthodoxe le mérite douteux d’avoir renforcé les structures néo-capitalistes dont la réorganisation actuelle porte en soi l’éloge du totalitarisme soviétique, mais bien de souligner combien les analyses les plus profondes de Marx sur l’aliénation se sont vulgarisées dans les faits d’une extrême banalité qui, dépouillés de leur carapace magique et matérialisés en chaque geste, forment à eux seuls et jour après jour la vie d’un nombre croissant de gens. En somme, le capitalisme bureaucratique contient la vérité évidente de l’aliénation, il l’a mise à la portée de tous mieux que Marx ne pouvait l’espérer, il l’a banalisée à mesure que, la misère s’atténuant, la médiocrité de l’existence faisait tache d’huile. Le paupérisme regagne en profondeur sur le mode de vie ce qu’il perd en étendue sur la stricte survie, voilà du moins un sentiment unanimement partagé qui lave Marx de toutes les interprétations qu’un bolchevisme dégénéré en tirait, même si la « théorie » de la coexistence pacifique intervient à point pour accélérer une telle prise de conscience et pousse le scrupule jusqu’à révéler, à qui aurait pu ne pas comprendre, qu’entre exploiteurs l’entente est possible en dépit des divergences spectaculaires.
2
« Tout acte, écrit Mircéa Éliade, est apte à devenir un acte religieux. L’existence humaine se réalise simultanément sur deux plans parallèles, celui du temporel, du devenir, de l’illusion et celui de l’éternité, de la substance, de la réalité. » Au XIXe siècle, la preuve est faite, par le divorce brutal des deux plans, qu’il eût été préférable pour le pouvoir de maintenir la réalité dans un bain de transcendance divine. Encore faut-il rendre au réformisme cette justice : où Bonaparte échoue, lui parvient à noyer le devenir dans l’éternité et le réel dans l’illusion ; l’union ne vaut pas les sacrements du mariage religieux mais elle dure, c’est le maximum que puissent exiger d’elle les managers de la coexistence et de la paix sociale. C’est aussi ce qui nous engage à nous définir — dans la perspective illusoire de la durée, à laquelle nul n’échappe — comme la fin de la temporalité abstraite, la fin du temps réifié de nos actes. Faut-il traduire : nous définir dans le pôle positif de l’aliénation comme fin de l’aliénation sociale, comme fin du stage de l’humanité dans l’aliénation sociale ?
3
La socialisation des groupes humains primitifs démontre une volonté de lutter plus efficacement contre les forces mystérieuses et terrifiantes de la nature. Mais lutter dans le milieu naturel, à la fois contre lui et avec lui, se soumettre à ses lois les plus inhumaines afin d’en arracher une chance de survie supplémentaire, cela ne pouvait que donner naissance à une forme plus évoluée de défense agressive, à une attitude plus complexe et moins primitive, présentant sur un plan supérieur les contradictions que ne cessaient de lui imposer les forces incontrôlées et cependant influençables de la nature. En se socialisant, la lutte contre la domination aveugle de la nature impose ses victoires dans la mesure où elle assimile peu à peu, mais sous une autre forme, l’aliénation primitive, l’aliénation naturelle. L’aliénation est devenue sociale dans le combat contre l’aliénation naturelle. Est-ce un hasard, une civilisation technicienne s’est développée à un point tel que l’aliénation sociale s’y est révélée en se heurtant aux derniers points de résistance naturelle que la puissance technique ne parvenait pas à réduire, et pour cause. Les technocrates nous proposent aujourd’hui de mener à sa fin l’aliénation primitive, dans un bel élan humanitaire, ils incitent à développer davantage les moyens techniques qui permettraient « en soi » de combattre efficacement la mort, la souffrance, le malaise, la fatigue de vivre. Mais le miracle serait moins de supprimer la mort que de supprimer le suicide et l’envie de mourir. Il y a une façon d’abolir la peine de mort qui fait qu’on la regrette. Jusqu’à présent, l’emploi particulier de la technique ou, plus largement, le contexte économico-social où se définit l’activité humaine, a diminué quantitativement les occasions de souffrance et de mort, tandis que la mort s’installait comme une maladie incurable dans la vie de chacun.
4
À la période préhistorique de la cueillette succède la période de chasse au cours de laquelle les clans se forment et s’efforcent d’augmenter leurs chances de survie. Pareille époque voit se constituer et se délimiter des réserves et des terrains de chasse exploités au profit du groupe et dont les étrangers demeurent exclus, interdiction d’autant plus absolue que sur elle repose le salut de tout le clan. De sorte que la liberté obtenue grâce à une installation plus confortable dans le milieu naturel et du même coup par une protection plus efficace contre ses rigueurs, cette liberté engendre sa négation en dehors des limites fixées par le clan et contraint le groupe à tempérer son activité licite par l’organisation de rapports avec les groupes exclus et menaçants. Dès son apparition, la survie économique socialement constituée postule l’existence de limites, de restrictions, de droits contradictoires. Il faut le rappeler comme on redit l’ABC, jusqu’à présent le devenir historique n’a cessé de se définir et de nous définir en fonction du mouvement d’appropriation privative, de la prise en charge par une classe, un groupe, une caste ou un individu d’un pouvoir général de survie économico-sociale dont la forme reste complexe, de la propriété d’une terre, d’un territoire, d’une usine, de capitaux — à l’exercice « pur » du pouvoir sur les hommes (hiérarchie). Au delà de la lutte contre les régimes qui placent leur paradis dans un
welfare-state cybernétique, apparaît la nécessité d’élargir le combat contre un état de choses fondamental et initialement naturel, dans le mouvement duquel le capitalisme ne joue qu’un rôle épisodique, et qui ne disparaîtra pas sans que disparaissent les dernières traces du pouvoir hiérarchisé ; ou les « marcassins de l’humanité », bien entendu.
5
Être propriétaire, c’est s’arroger un bien de la jouissance duquel on exclut les autres ; c’est, du même coup, reconnaître à chacun un droit abstrait de possession. En excluant du droit réel de propriété, le possédant étend sa propriété sur les exclus (absolument sur les non-possédants, relativement sur les autres possédants) sans lesquels il n’est rien. De leur côté, les non-possédants n’ont pas le choix. Il s’en approprie et les aliène en tant que producteurs de sa propre puissance tandis que la nécessité d’assurer leur existence physique les contraint de collaborer malgré eux à leur propre exclusion, à la produire et à survivre sur le mode de l’impossibilité de vivre. Exclus, ils participent à la possession par l’intermédiaire du possédant, participation mystique puisque, ainsi, s’organisent à l’origine tous les rapports claniques et tous les rapports sociaux, qui peu à peu succèdent au principe de cohésion obligée selon lequel chaque membre est fonction intégrante du groupe (« interdépendance organique »). Leur garantie de survie dépend de leur activité dans le cadre de l’appropriation privative, ils renforcent un droit de propriété dont ils sont écartés et, par cette ambiguïté, chacun d’eux se saisit comme participant à la propriété, comme parcelle vivante du droit de posséder, cependant qu’une telle croyance le définit à mesure qu’elle se renforce à la fois comme exclu et possédé. (Terme extrême de cette aliénation : l’esclave fidèle, le flic, le garde du corps, le centurion qui, par une sorte d’union avec sa propre mort, donne à la mort une puissance égale aux forces de vie, identifie dans une énergie destructrice le pôle négatif de l’aliénation et le pôle positif, l’esclave absolument soumis et le maître absolu). Dans l’intérêt de l’exploiteur, il importe que l’apparence se maintienne et s’affine ; nul machiavélisme à la clé mais un simple instinct de survie. L’organisation de l’apparence est liée à la survie du possédant, une survie liée à la survie de ses privilèges, et elle passe par la survie physique du non-possédant, une façon de rester vivant dans l’exploitation et l’impossibilité d’être homme. L’accaparement et la domination à des fins privées sont ainsi imposées et ressenties primitivement comme un droit positif, mais sur le mode d’une universalité négative. Valable pour tous, justifié aux yeux de tous par raison divine ou naturelle, le droit d’appropriation privative s’objective dans une illusion générale, dans une transcendance universelle, dans une loi essentielle où chacun, à titre individuel, trouve assez d’aise pour supporter les limites plus ou moins étroites assignées à son droit de vivre et aux conditions de vie en général.

6
Il faut comprendre la fonction de l’aliénation comme
condition de survie dans ce contexte social. Le travail des non-possédants obéit aux mêmes contradictions que le droit d’appropriation particulière. Il les transforme en possédés, en fabricants d’appropriation et en auteurs de leur propre exclusion mais il représente la seule chance de survie pour les esclaves, les serfs, les travailleurs, si bien que l’activité qui fait durer l’existence en lui ôtant tout contenu finit par prendre un sens positif par un renversement d’optique explicable et sinistre. Non seulement le travail a été valorisé (sous sa forme de sacrifice dans l’ancien régime, sous son aspect abrutissant dans l’idéologie bourgeoise et les démocraties prétendument populaires) mais, très tôt encore, travailler pour un maître, s’aliéner avec la bonne conscience de l’acquiescement, est devenu le prix honorable et à peine contestable de la survie. La satisfaction des besoins élémentaires reste la meilleure sauvegarde de l’aliénation, celle qui la dissimule le mieux en la justifiant sur la base d’une exigence inattaquable. L’aliénation rend les besoins innombrables parce qu’elle n’en satisfait aucun ; aujourd’hui, l’insatisfaction se mesure au nombre d’autos, frigos, TV : les objets aliénants n’ont plus la ruse ni le mystère d’une transcendance, ils sont là dans leur pauvreté concrète. Le riche est aujourd’hui celui qui possède le plus grand
nombre d’objets pauvres.
Survivre nous a, jusqu’à présent, empêchés de vivre. C’est pourquoi il faut attendre beaucoup de l’impossibilité de survie qui s’annonce désormais avec une évidence d’autant moins contestable que le confort et la surabondance dans les éléments de la survie nous acculent au suicide ou à la révolution.
7
Le sacré préside même à la lutte contre l’aliénation. Dès que, révélant sa trame, la couverture mystique cesse d’envelopper les rapports d’exploitation et la violence qui est l’expression de leur mouvement, la lutte contre l’aliénation se dévoile et se définit l’espace d’un éclair, l’espace d’une rupture, comme un corps à corps impitoyable avec le pouvoir mis à nu, découvert soudain dans sa force brutale et sa faiblesse, un géant où l’on fait mouche à tous coups mais dont chaque plaie confère à l’agresseur la renommée maudite d’Erostrate ; le pouvoir survivant, chacun y trouve son compte. Praxis de destruction, moment sublime où la complexité du monde devient tangible, cristalline, à portée de tous, révoltes inexpiables, comme celles des esclaves, des Jacques, des iconoclastes, des Enragés, des Fédérés, de Cronstadt, des Asturies et, promesses pour le futur, des blousons noirs de Stockholm et des grèves sauvages, voilà ce que seule la destruction de tout pouvoir hiérarchisé saura nous faire oublier ; nous comptons bien nous y employer.
L’usure des structures mythiques et leur retard à se renouveler qui rendent possible la prise de conscience et la profondeur critique du soulèvement sont aussi cause de ce que, passés les « excès » révolutionnaires, la lutte contre l’aliénation est saisie sur un plan théorique, comme prolongement de la démystification préparatoire à la révolte. C’est l’heure où la révolte dans son aspect le plus vrai, le plus authentiquement compris, se trouve réexaminée et jetée par dessus bord par le « nous n’avons pas voulu cela » des théoriciens chargés d’expliquer le sens d’une insurrection à ceux qui l’ont faite ; à ceux qui entendent démystifier par les faits, non seulement par les mots.
Tous les faits qui contestent le pouvoir exigent aujourd’hui une analyse et un développement tactique. Il faut attendre beaucoup :
a) du nouveau prolétariat qui découvre son dénuement dans l’abondance consommable (voir le développement des luttes ouvrières qui commencent actuellement en Angleterre ; aussi bien que l’attitude de la jeunesse rebelle dans tous les pays modernes).
b) des pays qui, insatisfaits de leurs révolutions parcellaires et truquées, relèguent au musée leurs théoriciens passés et présents (voir le rôle de l’intelligentsia dans les pays de l’Est).
c) du tiers-monde dont la méfiance à l’égard des mythes technicistes a été entretenue par les flics et les mercenaires du colonat, derniers militants trop zélés d’une transcendance dont ils sont les meilleurs vaccins préventifs.
d) de la force de l’I.S. (« nos idées sont dans toutes les têtes »), capable d’empêcher les révoltes télécommandées, les « nuits de cristal » et les révoltes acquiesçantes.
8
L’appropriation privative est liée à la dialectique du particulier et du général. Dans la mystique où se fondent les contradictions des systèmes esclavagiste et féodal, le non-possédant exclu en particulier du droit de possession, s’efforce par son travail d’assurer sa survie : il y réussit d’autant mieux qu’il s’efforce de s’identifier aux intérêts du maître. Il ne connaît les autres non-possédants qu’à travers leurs efforts pareils aux siens, cession obligée de la force de travail (le christianisme recommandera la cession volontaire ; l’esclavage cesse dès que l’esclave offre « de bon cœur » sa force de travail), recherche des conditions optima de survie et identifiaction mystique. Issue d’une volonté de survivre commune à tous, la lutte se livre cependant au niveau de l’apparence où elle met en jeu l’identification aux volontés du maître et déclenche donc une certaine rivalité individuelle qui reflète la rivalité des maîtres entre eux. La compétition se développera sur ce plan tant que les rapports d’exploitation resteront dissimulés dans l’opacité mystique et tant que subsisteront les conditions d’une telle opacité ; ou encore, tant que le degré d’esclavage déterminera dans la conscience de l’esclave le degré de réalité vécue. (Nous en sommes toujours à appeler conscience objective ce qui est conscience d’être objet). De son côté, le possédant se trouve lié à la reconnaissance d’un droit dont il est le seul à ne pas être exclu, mais qui est ressenti sur le plan de l’apparence comme un droit valable pour chaque exclu pris individuellement. Son privilège dépend d’une telle croyance, sur elle repose aussi la force indispensable pour faire face et tenir tête aux autres possédants, elle est sa force ; qu’à son tour il renonce apparemment à l’appropriation exclusive de toute chose et de tous, qu’il se pose moins en maître qu’en serviteur du bien public et en garant du salut commun, alors le prestige vient couronner la force, à ses privilèges il ajoute celui de nier au niveau de l’apparence (qui est le seul niveau de référence dans la communication tronquée) la notion même d’appropriation personnelle, il dénie ce droit à quiconque, il nie les autres possédants. Dans la perspective féodale, le possédant ne s’intègre pas dans l’apparence à la façon des non-possédants, esclaves, soldats, fonctionnaires, serviteurs de tout acabit. Ceux-ci connaissent une vie si sordide que, pour la plupart, il n’est d’autre choix que de la vivre comme une caricature du Maître (le féodal, le prince, le majordome, le garde-chiourme, le grand prêtre, Dieu, Satan…). Cependant, le maître est contraint de tenir le rôle d’une telle caricature. Il y réussit sans grand effort, tant il est déjà caricatural dans sa prétention de vivre totalement dans l’isolement où le tiennent ceux qui ne peuvent que survivre, il est déjà (avec la grandeur de l’époque révolue en sus, grandeur passée qui conférait à la tristesse une saveur désirable et forte) de cette espèce qui est la nôtre aujourd’hui, triste, pareil à chacun de nous guettant l’aventure où il brûle de se rejoindre, de se retrouver sur le chemin de sa totale perdition. Ce que le maître saisit des autres dans le moment même où il les aliène, serait-ce leur nature d’exclu et de possédé ? Dans ce cas, il se révélerait à lui-même comme exploiteur, comme être purement négatif. Une telle conscience est peu probable et dangereuse. En augmentant son autorité et son pouvoir sur le plus grand nombre possible de sujets, ne leur permet-il pas de se maintenir en vie, ne leur accorde-t-il pas une chance unque de salut ? (Sans les patrons qui daignent les employer, que deviendraient les ouvriers ? aimaient à répéter les bons esprits du XIXe siècle). En fait, le possédant s’exclut officiellement de la prétention d’appropriation privative. Au sacrifice du non-possédant qui par son travail échange sa vie réelle contre une vie apparente (la seule qui l’empêche de choisir délibérément la mort, et qui permet au maître de la choisir pour lui), le possédant répond en sacrifiant apparemment sa nature de possédant et d’exploiteur ; il s’exclut mythiquement, se met au service de tous et du mythe (au service de Dieu et de son peuple, par exemple). Par un geste de surplus, par une gratuité qui l’enveloppe d’une aura merveilleuse, il donne au renoncement sa pure forme de réalité mythique ; en renonçant à la vie commune, il est le pauvre parmi la richesse illusoire, celui qui se sacrifie pour tous au lieu que les autres ne se sacrifient que pour eux-mêmes, pour leur survie. Ce faisant, il transmue la nécessité où il se trouve en prestige. Son sacrifice est tout à la mesure de sa puissance. Il devient le point de référence vivant de toute la vie illusoire, la plus haute échelle tangible des valeurs mythiques. Éloigné « volontairement » du commun des mortels, c’est vers le monde des dieux qu’il tend, et c’est sa participation plus ou moins avérée à la divinité qui, au niveau de l’apparence (le seul niveau de référence communément admis), consacre sa place dans la hiérarchie des autres possédants. Dans l’organisation de la transcendance, le féodal — et par osmose, les propriétaires d’un pouvoir ou de biens de production, à des degrés divers — est amené à jouer le rôle principal, le rôle qu’il joue effectivement dans l’organisation économique de la survie du groupe. De sorte que l’existence du groupe se trouve liée sur tous les plans à l’existence des possédants en tant que tels, à ceux qui, propriétaires de toute chose par la propriété de tout être, arrachent également le renoncement de tous par leur renoncement unique, absolu, divin. (Du dieu Prométhée par les dieux au dieu Christ puni par les hommes, le sacrifice du Propriétaire se vulgarise, perd en sacré, s’humanise.) Le mythe unit donc possédant et non-possédant, il les enrobe dans une forme où la nécessité de survivre, comme être physique ou comme être privilégié, contraint de vivre sur le mode de l’apparence et sous le signe inversé de la vie réelle, qui est celle de la praxis quotidienne. Nous en sommes toujours là, attendant de vivre au delà ou en deçà d’une mystique contre laquelle chacun de nos gestes proteste en y obéissant.
9
Le mythe, l’absolu unitaire où les contradictions du monde se retrouvent illusoirement résolues, la vision à chaque instant harmonieuse et harmonisée où l’ordre se contemple et se renforce, voilà le lieu du sacré, la zone extra-humaine d’où est soigneusement bannie, parmi tant de révélations, la révélation du mouvement d’appropriation privative. Nietzsche l’a bien vu, qui écrit : « Tout devenir est une émancipation coupable à l’egard de l’être éternel, qu’il faut payer de mort ». Lorsqu’à l’Être pur de la féodalité, la bourgeoisie prétendra substituer le Devenir, elle se bornera en fait à désacraliser l’être et à resacraliser pour son plus grand profit le Devenir, son devenir ainsi élevé à l’Être, non plus de la propriété absolue, mais bien de l’appropriation relative ; un petit devenir démocratique et mécanique, avec sa notion de progrès, de mérite et de succession causale. Ce que le possédant vit le dissimule à lui-même ; lié au mythe par un pacte de vie ou de mort, il lui est interdit de se saisir dans sa jouissance positive et exclusive d’un bien, si ce n’est à travers l’apparence vécue de sa propre exclusion — et n’est-ce pas à travers cette exclusion mythique que les non-possédants saisiront la réalité de leur exclusion ? Il porte la responsabilité d’un groupe, il assume le poids d’un dieu. Soumis à sa bénédiction comme à sa vengeance, il se drape d’interdit et s’y consume. Modèle de dieux et de héros, le maître, le possédant est le vrai visage de Prométhée, du Christ, de tous les sacrifiés spectaculaires qui ont permis que ne cessent de se sacrifier aux maîtres, à l’extrême minorité, « la très grande majorité des hommes » (il conviendrait d’ailleurs de nuancer l’analyse du sacrifice du propriétaire : dans le cas du Christ, ne faudrait-il pas admettre qu’il s’agit plus précisément du fils du propriétaire ? Or, si le propriétaire ne peut jamais se sacrifier que dans l’apparence, on assiste bel et bien à l’immolation effective, quand la conjoncture l’exige impérieusement, du fils du propriétaire ; en tant qu’il n’est véritablement qu’un propriétaire très inachevé, une ébauche, une simple espérance de propriété future. C’est dans cette dimension mythique qu’il faut comprendre la fameuse phrase de Barrès, journaliste, au moment où la guerre de 1914 était enfin venue combler ses vœux : « Notre jeunesse, comme il convenait, est allée verser à flots
notre sang. »). Ce jeu passablement dégoûtant a d’ailleurs connu, avant de rejoindre les rites et le folklore, une époque héroïque où rois et chefs de tribu étaient rituellement mis à mort selon leur « volonté ». On en vint rapidement, assurent les historiens, à remplacer les augustes martyrs par des prisonniers, des esclaves ou des criminels. Le supplice disparu, l’auréole est restée.
10
Le sacrifice du possédant et du non-possédant fonde le concept de sort commun ; en d’autres termes, la notion de condition humaine se définit sur la base d’une image idéale et douloureuse où tente de se résoudre l’opposition irréductible entre le sacrifice mythique des uns et la vie sacrifiée des autres. Au mythe appartient la fonction d’unifier et d’éterniser, en une succession d’instants statiques, la dialectique du « vouloir-vivre » et de son contraire. Une telle unité factice et partout dominante atteint dans la communication, et en particulier dans le langage, sa représentation la plus tangible, la plus concrète. À ce niveau, l’ambiguïté est plus manifeste, elle s’ouvre sur l’absence de communication réelle, elle livre l’analyste à des fantômes dérisoires, à des mots — instants éternels et changeants — qui diffèrent de contenu selon celui qui les prononce, comme diffère la notion de sacrifice. Mis à l’épreuve, le langage cesse de dissimuler le malentendu fondamental et débouche sur la crise de participation. Dans le langage d’une époque, on peut suivre à la trace la révolution totale, inaccomplie et toujours imminente. Ce sont des signes exaltants et effrayants par les bouleversements qu’ils augurent, mais qui les prendrait au sérieux ? Le discrédit qui frappe le langage est aussi profond et aussi instinctif que la méfiance dont on entoure les mythes, auxquels on reste par ailleurs fermement attachés. Comment cerner les mots-clés avec d’autres mots ? Comment montrer à l’aide de phrases quels signes dénoncent l’organisation phraséologique de l’apparence ? Les meilleurs textes attendent leur justification. Quand un poème de Mallarmé apparaîtra comme seule explication d’un acte de révolte, alors il sera permis de parler sans ambiguïté de poésie et de révolution. Attendre et préparer ce moment, c’est manipuler l’information, non comme la dernière onde de choc dont tout le monde ignore l’importance, mais bien comme la première répercussion d’un acte à venir.
11
Né dans la volonté des hommes de survivre aux forces incontrôlables de la nature, le mythe est une politique de salut public qui s’est maintenue au-delà de sa nécessité, et s’est confirmée dans sa force tyrannique en réduisant la vie à l’unique dimension de la survie, en la niant comme mouvement et totalité.
Contesté, le mythe unifie ses contestations, il les englobe et les digère tôt ou tard. Rien ne lui résiste de ce qui, image ou concept, tente de détruire les structures spirituelles et dominantes. Il règne sur l’expression des faits et du vécu à laquelle il impose sa structure interprétative (dramatisation). La conscience du vécu qui trouve son expression au niveau de l’apparence organisée définit la conscience privée.
Le sacrifice compensé nourrit le mythe. Puisque toute vie individuelle implique un renoncement à soi-même, il faut que le vécu se définisse comme sacrifice et récompense. Pour prix de son ascèse, l’initié (l’ouvrier promu, le spécialiste, le manager — nouveaux martyrs canonisés démocratiquement) reçoit un abri taillé dans l’organisation de l’apparence, il s’installe confortablement dans l’aliénation. Or, les abris collectifs ont disparu avec les sociétés unitaires, seules subsistent leurs traductions concrètes à l’usage du commun : temples, églises, palais…, souvenirs d’une protection universelle. Restent aujourd’hui les abris individuels, dont on peut contester l’efficacité, mais dont on connaît le prix en toute certitude.
12
La vie « privée » se définit avant tout dans un contexte formel. Certes, elle prend naissance dans les rapports sociaux nés de l’appropriation privative, mais c’est l’expression de ces rapports qui lui donne sa forme essentielle. Universelle, incontestable et à chaque instant contestée, une telle forme fait de l’appropriation un droit reconnu à tous et dont chacun est exclu,
un droit auquel on n’accède qu’en y renonçant. Pour autant qu’il ne brise pas le contexte où il se trouve emprisonné (rupture qui a nom révolution), le vécu le plus authentique n’est pris en conscience, exprimé et communiqué que par un mouvement d’inversion de signe où sa contradiction fondamentale se dissimule. En d’autres termes, s’il renonce à prolonger une praxis de bouleversement radical des conditions de vie — conditions qui, sous toutes leurs formes, sont celles de l’appropriation privative, — un projet positif n’a pas la moindre occasion d’échapper à une prise en charge par la négativité qui règne sur l’expression des rapports sociaux ; il est récupéré comme l’image dans le miroir, en sens inverse. Dans la perspective totalisante où il conditionne toute la vie de tous, et où ne se distinguent plus son pouvoir réel et son pouvoir mythique (tous deux réels et tous deux mythiques), le mouvement d’appropriation privative ne laisse au vécu d’autre voie d’expression que la voie négative. La vie tout entière baigne dans une négativité qui la corrode et la définit formellement. Parler de vie sonne aujourd’hui comme parler de corde dans la maison d’un pendu. Perdue la clé du vouloir-vivre, toutes les portes s’ouvrent sur des tombes. Or, le dialogue du coup de dé et du hasard ne suffit plus pour justifier notre lassitude ; ceux qui acceptent encore de vivre en garni dans leur propre fatigue se font plus aisément d’eux-mêmes une image indolente qu’ils n’observent en chacun de leurs gestes quotidiens un démenti vivant de leur désespoir, un démenti qui devrait plutôt les inciter à ne désespérer que de leur pauvreté d’imagination. De ces images qui sont comme un oubli de vivre, l’éventail du choix s’ouvre entre deux extrêmes : la brute conquérante et la brute esclave d’une part, de l’autre, le saint et le héros pur. Il y a beau temps qu’en ce lieu d’aisance, l’air est devenu irrespirable. Le monde et l’homme comme représentation puent la charogne et nul dieu n’est présent désormais pour changer les charniers en parterre de muguet. Depuis le temps que les hommes meurent, il serait assez logique que l’on se pose la question de savoir — après avoir, sans changements appréciables, accepté la réponse venue des dieux, de la Nature et des lois biologiques — si cela ne tient pas à ce qu’une grande part de mort entre, pour des raisons très précises, dans chaque instant de notre vie.
13
L’appropriation privative peut notamment se définir comme appropriation des choses par l’appropriation des êtres. Elle est la source et l’eau trouble où tous les reflets se confondent en images indistinctes. Son champ d’action et d’influence, qui recouvre toute l’histoire, semble s’être caractérisé jusqu’à présent par une double détermination comportementale de base : une ontologie fondée sur la négation de soi et le sacrifice (ses aspects respectivement objectif et subjectif) et une dualité fondamentale, une division entre particulier et général, individuel et collectif, privé et public, théorique et pratique, spirituel et matériel, intellectuel et manuel, etc. La contradiction entre appropriation universelle et expropriation universelle postule une mise en évidence et un esseulement du maître. Cette image mythique de terreur, de nécessité et de renoncement s’offre aux esclaves, aux serviteurs, à tous ceux qui aspirent à changer de peau et de condition, elle est le reflet illusoire de leur participation à la propriété, illusion naturelle puisqu’ils y participent effectivement par le sacrifice quotidien de leurs énergies (ce que les anciens nommaient peine ou supplice et que nous appelons labeur ou travail), puisque, cette propriété, ils la fabriquent dans le sens où elle les exclut. Le maître, lui, n’a d’autre choix que de se cramponner à la notion de sacrifice-travail, comme le Christ à sa croix et à ses clous ; à lui d’authentifier le sacrifice à sa façon, de renoncer apparemment à son droit de jouissance exclusive et de cesser d’exproprier en usant d’une violence purement
humaine (c’est-à-dire sans médiation). Le sublime du geste estompe la violence initiale, la noblesse du sacrifice absout l’homme des troupes spéciales, la brutalité du conquérant s’irradie dans une transcendance dont le règne est immanent, les dieux sont les dépositaires intransigeants des droits, les bergers irrascibles d’un troupeau pacifique et paisible d’« Être et de Vouloir-Être Propriétaire ». Le pari sur la transcendance et le sacrifice qu’il implique sont la plus belle conquête du maître, sa plus belle soumission à la nécessité de conquérir. Qui brigue quelque pouvoir et refuse la purification du renoncement (brigand ou tyranneau) se verra tôt ou tard traquer comme une bête, ou pis, comme celui qui ne poursuit d’autres fins que les siennes et pour qui le « travail » se conçoit sans la moindre concession à la sérénité d’esprit des autres : Troppmann, Landru, Petiot équilibrant leur budget sans y porter en compte la défense du monde libre, de l’Occident chrétien, de l’État ou de la valeur humaine, partaient vaincus d’avance. En refusant les règles du jeu, pirates, gangsters, hors-la-loi troublent les bonnes consciences (les consciences-reflets du mythe), mais les maîtres en tuant le braconnier ou en le faisant gendarme rendent sa toute-puissance à la « vérité de toujours » : qui ne paie de sa personne perd jusqu’à la survie, qui s’endette pour payer a droit de vie payé. Le sacrifice du maître est ce qui donne ses contours à l’humanisme, ce qui fait de l’humanisme — et que ceci soit entendu une fois pour toutes — la négation dérisoire de l’humain. L’humanisme, c’est le maître pris au sérieux dans son propre jeu et plébiscité par ceux qui voient dans le sacrifice apparent, ce reflet caricatural de leur sacrifice réel, une raison d’espérer le salut. Justice, dignité, grandeur, liberté… ces mots qui jappent ou gémissent sont-ils autre chose que des chiots d’appartement, dont les maîtres attendent le retour en toute sérénité depuis que d’héroïques larbins ont arraché le droit de les mener en laisse au gré des rues ? Les employer, c’est oublier qu’ils sont le lest grâce auquel le pouvoir s’élève et se met hors d’atteinte. Et à supposer qu’un régime, jugeant que le sacrifice mythique des maîtres n’a pas à se vulgariser dans des formes aussi universelles, s’acharne à les détruire et à les pourchasser, on est en droit de s’inquiéter de ce que la gauche ne trouve pour le combattre qu’une logomachie bêlante où chaque mot, rappelant le « sacrifice » d’un maître ancien, appelle le sacrifice non moins mythique d’un maître nouveau (un maître de gauche, un pouvoir qui fusillera les travailleurs au nom du prolétariat). Lié à la notion de sacrifice, ce qui définit l’humanisme appartient à la peur des maîtres et à la peur des esclaves, il n’est que solidarité dans une humanité foireuse. Mais n’importe quel mot prend la valeur d’une arme dès qu’il sert à scander l’action de quiconque refuse tout pouvoir hiérarchisé, Lautréamont et les anarchistes illégalistes l’avaient déjà compris, les dadaïstes aussi.
L’appropriateur devient donc possédant dès l’instant qu’il remet la propriété des êtres et des choses entre les mains de Dieu, ou d’une transcendance universelle, dont la toute-puissance rejaillit sur lui comme une grâce sanctifiant ses moindres gestes ; contester le propriétaire ainsi consacré, c’est s’en prendre à Dieu, à la nature, à la patrie, au peuple. S’exclure, en somme, du monde physique et spirituel. Pour qui assortit de violence l’humour de Marcel Havrenne écrivant si joliment « il ne s’agit pas de gouverner et encore moins de l’être », il n’y a ni salut ni damnation, pas de place dans la compréhension universelle des choses, ni chez Satan,
le grand récupérateur de croyants (1), ni dans le mythe quel qu’il soit, puisqu’il en est la vivante inutilité. Ceux-là sont nés pour une vie qui reste à inventer ; dans la mesure où ils ont vécu, c’est sur cet espoir qu’ils ont fini par se tuer.
De la singularisation dans la transcendance, deux corollaires :
a) si ontologie implique transcendance, il est clair que toute ontologie justifie a priori l’être du maître et le pouvoir hiérarchisé où le maître se reflète en images dégradées plus ou moins fidèles.
b) à la distinction entre travail manuel et travail intellectuel, pratique et théorie, s’ajoute en surimpression la distinction entre le travail-sacrifice-réel et son organisation sur le mode du sacrifice apparent.
Il serait assez tentant d’expliquer le fascisme — entre autres raisons — comme un acte de foi, l’autodafé d’une bourgeoisie hantée par le meurtre de Dieu et par la destruction du grand spectacle sacré, et qui se voue au diable, à une mystique inversée, une mystique noire avec ses rites et ses holocaustes. Mystique et grand capital.
Rappelons aussi que le pouvoir hiérarchisé ne se conçoit pas sans transcendances, sans idéologies, sans mythes. Le mythe de la démystification est d’ailleurs prêt à prendre la relève, il suffit d’« omettre », très philosophiquement, de démystifier
par les actes. Après quoi, toute démystification proprement désamorcée devient indolore, euthanasique, pour tout dire humanitaire. N’était le mouvement de démystification, qui finira par démystifier les démystificateurs.
Raoul VANEIGEM
(la suite au prochain numéro)
* Qu'adviendra-t-il de la totalité, inhérente à la société unitaire, aux prises avec la démolition bourgeoise de cette unité ?* Une reconstitution factice de l'unité parviendra-telle à abuser le travailleur aliéné dans la consommation ?* Mais quel pourrait être l'avenir de la totalité dans une société parcellaire ?* Quel dépassement inattendu de cette société, et de toute son organisation de l'apparence, nous mènera-t-il à un dénouement heureux ?- C'est ce que vous devriez savoir, et qui sera exposé dans la deuxième partie de cette étude !Raoul VANEIGEM,
« Banalités de base », Internationale Situationniste, bulletin central édité par les sections de l'Internationale situationniste, numéro 7, avril 1962 (La rédaction de ce bulletin appartient au Conseil Central de l'I.S. : Debord, Kotanyi, Lausen, Vaneigem)
Tous les textes publiés dans « INTERNATIONALE SITUATIONNISTE » peuvent être librement reproduits, traduits ou adaptés même sans indication d'origine.___________________
(1) Souligné par Vie moderne.