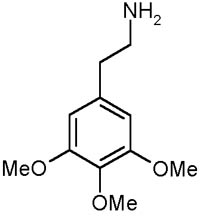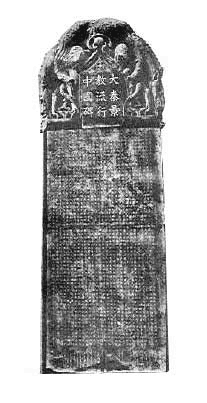Théorie de la dérive Entre les divers procédés situationnistes, la dérive se présente comme une technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d’effets de nature psychogéographique, et à l’affirmation d’un comportement ludique-constructif, ce qui l’oppose en tous points aux notions classiques de voyage et de promenade.
Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent, pour une durée plus ou moins longue, aux raisons de se déplacer et d’agir qu’elles se connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. La part de l’aléatoire est ici moins déterminante qu’on ne croit : du point de vue de la dérive, il existe un relief psychogéographique des villes, avec des courants constants, des points fixes, et des tourbillons qui rendent l’accès ou la sortie de certaines zones fort malaisés.
Mais la dérive, dans son unité, comprend à la fois ce laisser-aller et sa contradiction nécessaire : la domination des variations psychogéographiques par la connaissance et le calcul de leurs possibilités. Sous ce dernier aspect, les données mises en évidence par l’écologie, et si borné que soit a priori l’espace social dont cette science se propose l’étude, ne laissent pas de soutenir utilement la pensée psychogéographique.
L’analyse écologique du caractère absolu ou relatif des coupures du tissu urbain, du rôle des microclimats, des unités élémentaires entièrement distinctes des quartiers administratifs, et surtout de l’action dominante de centres d’attraction, doit être utilisée et complétée par la méthode psychogéographique. Le terrain passionnel objectif où se meut la dérive doit être défini en même temps selon son propre déterminisme et selon ses rapports avec la morphologie sociale.

Chombart de Lauwe dans son étude sur
Paris et l’agglomération parisienne (Bibliothèque de Sociologie Contemporaine, P.U.F. 1952) note qu’« un quartier urbain n’est pas déterminé seulement par les facteurs géographiques et économiques mais par la représentation que ses habitants et ceux des autres quartiers en ont » ; et présente dans le même ouvrage — pour montrer « l’étroitesse du Paris réel dans lequel vit chaque individu… géographiquement un cadre dont le rayon est extrêmement petit » — le tracé de tous les parcours effectués en une année par une étudiante du XVIe arrondissement ; ces parcours dessinent un triangle de dimension réduite, sans échappées, dont les trois sommets sont l’École des Sciences Politiques, le domicile de la jeune fille et celui de son professeur de piano.
Il n’est pas douteux que de tels schémas, exemples d’une poésie moderne susceptible d’entraîner de vives réactions affectives — dans ce cas l’indignation qu’il soit possible de vivre de la sorte —, ou même la théorie, avancée par Burgess à propos de Chicago, de la répartition des activités sociales en zones concentriques définies, ne doivent servir aux progrès de la dérive.
Le hasard joue dans la dérive un rôle d’autant plus important que l’observation psychogéographique est encore peu assurée. Mais l’action du hasard est naturellement conservatrice et tend, dans un nouveau cadre, à tout ramener à l’alternance d’un nombre limité de variantes, et à l’habitude. Le progrès n’étant jamais que la rupture d’un des champs où s’exerce le hasard, par la création de nouvelles conditions plus favorables à nos desseins, on peut dire que les hasards de la dérive sont foncièrement différents de ceux de la promenade, mais que les premières attirances psychogéographiques découvertes risquent de fixer le sujet ou le groupe dérivant autour de nouveaux axes habituels, où tout les ramène constamment.
Une insuffisante défiance à l’égard du hasard, et de son emploi idéologique toujours réactionnaire, condamnait à un échec morne la célèbre déambulation sans but tentée en 1923 par quatre surréalistes à partir d’une ville tirée au sort : l’errance en rase campagne est évidemment déprimante, et les interventions du hasard y sont plus pauvres que jamais. Mais l’irréflexion est poussée bien plus loin dans Médium (mai 1954), par un certain Pierre Vendryes qui croit pouvoir rapprocher de cette anecdote — parce que tout cela participerait d’une même libération antidéterministe — quelques expériences probabilistes, par exemple sur la répartition aléatoire de têtards de grenouille dans un cristallisoir circulare, dont il donne le fin mot en précisant : « il faut, bien entendu, qu’une telle foule ne subisse de l’extérieur aucune influence directrice ». Dans ces conditions, la palme revient effectivement aux têtards qui ont cet avantage d’être « aussi dénués que possible d’intelligence, de sociabilité et de sexualité », et, par conséquent, « vraiment indépendants les uns des autres ».
Aux antipodes de ces aberrations, le caractère principalement urbain de la dérive, au contact des centres de possibilités et de significations que sont les grandes villes transformées par l’industrie, répondrait plutôt à la phrase de Marx : « Les hommes ne peuvent rien voir autour d’eux qui ne soit leur visage, tout leur parle d’eux-mêmes. Leur paysage même est animé. »
On peut dériver seul, mais tout indique que la répartition numérique la plus fructueuse consiste en plusieurs petits groupes de deux ou trois personnes parvenues à une même prise de conscience, le recoupement des impressions de ces différents groupes devant permettre d’aboutir à des conclusions objectives. Il est souhaitable que la composition de ces groupes change d’une dérive à l’autre. Au-dessus de quatre ou cinq participants, le caractère propre à la dérive décroît rapidement, et en tout cas il est impossible de dépasser la dizaine sans que la dérive ne se fragmente en plusieurs dérives menées simultanément. La pratique de ce dernier mouvement est d’ailleurs d’un grand intérêt, mais les difficultés qu’il entraîne n’ont pas permis jusqu’à présent de l’organiser avec l’ampleur désirable.
La durée moyenne d’une dérive est la journée, considérée comme l’intervalle de temps compris entre deux périodes de sommeil. Les points de départ et d’arrivée, dans le temps, par rapport à la journée solaire, sont indifférents, mais il faut noter cependant que les dernières heures de la nuit sont généralement impropres à la dérive.
Cette durée moyenne de la dérive n’a qu’une valeur statistique. D’abord, elle se présente assez rarement dans toute sa pureté, les intéressés évitant difficilement, au début ou à la fin de cette journée, d’en distraire une ou deux heures pour les employer à des occupations banales ; en fin de journée, la fatigue contribue beaucoup à cet abandon. Mais surtout la dérive se déroule souvent en quelques heures délibérément fixées, ou même fortuitement pendant d’assez brefs instants, ou au contraire pendant plusieurs jours sans interruption. Malgré les arrêts imposés par la nécessité de dormir, certaines dérives d’une intensité suffisante se sont prolongées trois ou quatre jours, voire même d’avantage. Il est vrai que dans le cas d’une succession de dérives pendant une assez longue période, il est presque impossible de déterminer avec quelque précision le moment où l’état d’esprit propre à une dérive donnée fait place à un autre. Une succession de dérives a été poursuivie sans interruption notable jusqu’aux environs de deux mois, ce qui ne va pas sans amener de nouvelles conditions objectives de comportement qui entraînent la disparition de bon nombres des anciennes.
L’influence sur la dérive des variations du climat, quoique réelle, n’est déterminante que dans le cas de pluies prolongées qui l’interdisent presque absolument. Mais les orages ou les autres espèces de précipitations y sont plutôt propices.
Le champ spatial de la dérive est plus ou moins précis ou vague selon que cette activité vise plutôt à l’étude d’un terrain ou à des résultats affectifs déroutants. Il ne faut pas négliger le fait que ces deux aspects de la dérive présentent de multiples interférences et qu’il est impossible d’en isoler un à l’état pur. Mais enfin l’usage des taxis, par exemple, peut fournir une ligne de partage assez claire : si dans le cours d’une dérive on prend un taxi, soit pour une destination précise, soit pour se déplacer de vingt minutes vers l’ouest, c’est que l’on s’attache surtout au dépaysement personnel. Si l’on tient à l’exploration directe d’un terrain, on met en avant la recherche d’un urbanisme psychogéographique.
Dans tous les cas le champ spatial est d’abord fonction des bases de départ constituées, pour les sujets isolés, par leurs domiciles, et pour les groupes, par les points de réunion choisis. L’étendue maximum de ce champ spatial ne dépasse pas l’ensemble d’une grande ville et de ses banlieues. Son étendue minimum peut être bornée à une petite unité d’ambiance : un seul quartier, ou même un seul îlot s’il en vaut la peine (à l’extrême limite la dérive-statique d’une journée sans sortir de la gare Lazare).
L’exploration d’un champ spatial fixé suppose donc l’établissement de bases, et le calcul des directions de pénétration. C’est ici qu’intervient l’étude des cartes, tant courantes qu’écologiques ou psychogéographiques, la rectification et l’amélioration de ces cartes. Est-il besoin de dire que le goût du quartier en lui-même inconnu, jamais parcouru, n’intervient aucunement ? Outre son insignifiance, cet aspect du problème est tout à fait subjectif, et ne subsite pas longtemps. Ce critère n’a jamais été employé, si ce n’est, occasionnellement, quand il s’agit de trouver les issues psychogéographiques d’une zone en s’écartant systématiquement de tous les points coutumiers. On peut alors s’égarer dans des quartiers déjà fort parcourus.
La part de l’exploration au contraire est minime, par rapport à celle d’un comportement déroutant, dans le « rendez-vous possible ». Le sujet est prié de se rendre seul à une heure qui est précisée dans un endroit qu’on lui fixe. Il est affranchi des pénibles obligations du rendez-vous ordinaire, puisqu’il n’a personne à attendre. Cependant ce « rendez-vous possible » l’ayant mené à l’improviste en un lieu qu’il peut connaître ou ignorer, il en observe les alentours. On a pu en même temps donner au même endroit un autre « rendez-vous possible » à quelqu’un dont il ne peut prévoir l’identité. Il peut même ne l’avoir jamais vu, ce qui incite à lier conversation avec divers passants. Il peut ne rencontrer personne, ou même rencontrer par hasard celui qui a fixé le « rendez-vous possible ». De toute façon, et surtout si le lieu et l’heure ont été bien choisis, l’emploi du temps du sujet y prendra une tournure imprévue. Il peut même demander par téléphone un autre « rendez-vous possible » à quelqu’un qui ignore où le premier l’a conduit. On voit les ressources presques infinies de ce passe-temps.
Ainsi, quelques plaisanteries d’un goût dit douteux, que j’ai toujours vivement appréciées dans mon entourage, comme par exemple s’introduire nuitamment dans les étages des maisons en démolition, parcourir sans arrêt Paris en auto-stop pendant une grève des transports, sous le prétexte d’aggraver la confusion en se faisant conduire n’importe où, errer dans ceux des souterrains des catacombes qui sont interdits au public, relèveraient d’un sentiment plus général qui ne serait autre que le sentiment de la dérive.
*
Les enseignements de la dérive permettent d’établir les premiers relevés des articulations psychogéographiques d’une cité moderne. Au-delà de la reconnaissance d’unités d’ambiances, de leurs composantes principales et de leur localisation spatiale, on perçoit leurs axes principaux de passage, leurs sorties et leurs défenses. On en vient à l’hypothèse centrale de l’existence de plaques tournantes psychogéographiques. On mesure les distances qui séparent effectivement deux régions d’une ville, et qui sont sans commune mesure avec ce qu’une vision approximative d’un plan pouvait faire croire. On peut dresser, à l’aide des vieilles cartes, de vues photographiques aériennes et de dérives expérimentales une cartographie influentielle qui manquait jusqu’à présent, et dont l’incertitude actuelle, inévitable avant qu’un immense travail ne soit accompli, n’est pas pire que celle des premiers portulans, à cette différence près qu’il ne s’agit plus de délimiter précisément des continents durables, mais de changer l’architecture et l’urbanisme.
Les différentes unités d’atmosphère et d’habitation, aujourd’hui, ne sont pas exactement tranchées, mais entourées de marges frontières plus ou moins étendues. Le changement le plus général que la dérive conduit à proposer, c’est la diminution constante de ces marges frontières, jusqu’à leur suppression complète.
Dans l’architecture même, le goût de la dérive porte à préconiser toutes sortes de nouvelles formes du labyrinthe, que les possiblités modernes de construction favorisent. Ainsi, la presse signalait en mars 1955 la construction à New-York d’un immeuble où l’on peut voir les premiers signes d’une occasion de dérive à l’intérieur d’un appartement :
« Les logements de la maison hélicoïdale auront la forme d’une tranche de gâteau. Ils pourront être agrandis ou diminués à volonté par le déplacement de cloisons mobiles. La gradation par demi-étage évite de limiter le nombre de pièces, le locataire pouvant demander à utiliser la tranche suivante en surplomb ou en contrebas. Ce système permet de transformer en six heures trois appartements de quatre pièces en un appartement de douze pièces ou plus. »

Le sentiment de la dérive se rattache naturellement à une façon plus générale de prendre la vie, qu’il serait pourtant maladroit d’en déduire mécaniquement. Je ne m’étendrai ni sur les précurseurs de la dérive, que l’on peut reconnaître justement, ou détourner abusivement, dans la littérature du passé, ni sur les aspects passionnels particuliers que cette activité entraîne. Les difficultés de la dérive sont celles de la liberté. Tout porte à croire que l’avenir précipitera le changement irréversible du comportement et du décor de la société actuelle. Un jour, on construira des villes pour dériver. On peut utiliser, avec des retouches relativement légères, certaines zones qui existent déjà. On peut utiliser certaines personnes qui existent déjà.
Guy-Ernest DEBORD, « Théorie de la dérive »,
Les Lèvres nues, numéro 9, novembre 1956
***
Deux comptes rendus de dériveI. Rencontres et troubles consécutifs à une dérive continueLe soir du 25 décembre 1953, les lettristes G[illes] I[vain], G[uy] D[ebord] et G[aëtan] L[anglais], entrant dans un bar algérien de la rue Xavier-Privas où ils ont passé toute la nuit précédente — et qu’ils appellent depuis longtemps « Au Malais de Thomas » — sont amenés à converser avec un Antillais d’environ quarante ans, d’une élégance assez insolite parmi les habitués de ce bouge, qui, à leur arrivée, parlait avec K., le tenancier du lieu.
L’homme demande aux lettristes, contre toute vraisemblance, s’ils ne sont pas « dans l’armée ». Puis, sur leur réponse négative, il insiste vainement pour savoir « à quelle organisation ils appartiennent ». Il se présente lui-même sous le nom, manifestement faux, de Camille J. La suite de ses propos est parsemée de coïncidences (les adresses qu’il cite, les préoccupations qui sont celles de ses interlocuteurs cette semaine-là, son anniversaire qui est aussi celui de G.I.) et de phrases qu’il veut à double sens, et qui semblent être des allusions délibérées à la dérive. Mais le plus remarquable est son délire croissant qui tourne autour d’une idée de voyage pressé — « il voyage continuellement » et le répète souvent. J. en vient à dire sérieusement qu’arrivant de Hambourg il avait cherché l’adresse du bar où ils sont à présent — il y était venu autrefois, un instant, l’avait aimé —, ne la trouvant pas, il avait fait un saut à New-York pour la demander à sa femme — ; et l’adresse n’étant pas non plus à New-York, c’est fortuitement qu’il venait de retrouver le bar. Il arrive d’Orly. (Aucun avion n’a atterri depuis plusieurs jours à Orly, par suite d’une grève du personnel de la sécurité compliquée de mauvaise visibilité, et G.D. le sait parce que lui-même est arrivé l’avant-veille, par train, après avoir été retardé deux jours sur l’aérodrome de Nice). J. déclare à G.L., d’un air de certitude attristée, que ses activités actuelles doivent être au-dessus de ses capacités (G.L. sera en effet exclu deux mois plus tard). J. propose aux lettristes de les retrouver au même endroit le lendemain : il leur fera goûter un excellent rhum « de sa plantation ». Il a aussi parlé de leur faire connaître sa femme, mais ensuite, et sans contradiction apparente, il a dit que le lendemain « il serait veuf », sa femme partant de bon matin pour Nice en automobile.
Après qu’il soit sorti, K., interrogé (lui-même ignore tout des activités des lettristes), ne peut rien dire sinon qu’il l’a vu boire un verre une fois, il y a quelques mois.
Le lendemain J. vient au rendez-vous avec sa femme, une Antillaise de son âge, assez belle. Il fait, avec son rhum, un punch hors de pair. J. et sa femme exercent une attraction d’une nature peu claire sur tous les Algériens du bar, à la fois enthousiastes et déférents. Une agitation d’une intensité très inhabituelle se traduit par le fracas de toutes les guitares ensemble, des cris, des danses. J. rétablit instantanément le calme en portant un toast imprévu « à nos frères qui meurent sur les champs de bataille » (bien qu’à cette date, nulle part hors d’Indochine il n’y ait de lutte armée de quelque envergure). La conversation atteint en valeur délirante celle de la veille, mais cette fois avec la participation de la femme de J. Remarquant qu’une bague que J. portait le soir précédent est maintenant au doigt de sa femme, G.L. dit assez bas à G.I., faisant allusion à leurs commentaires de la veille qui n’avaient pas manqué d’évoquer les zombies et les signes de reconnaissance de sectes secrètes : « Le Vaudou a changé de main ». La femme de J. entend cette phrase et sourit d’un air complice.
Après avoir encore parlé des rencontres et des lieux qui les provoquent, J. déclare à ses interlocuteurs qu’il ne sait pas si lui-même les rencontrera un jour, car ils sont « peut-être trop forts pour lui ». On l’assure du contraire. Au moment de se séparer G.I. propose de donner à la femme de J., puisqu’elle doit partir pour Nice, l’adresse d’un bar assez attirant dans cette ville. J. répond alors froidement que c’est malheureusement trop tard puisqu’elle est partie depuis le matin. Il prend congé en affirmant que maintenant il est sûr qu’ils se reverront un jour « serait-ce même dans un autre monde » — ajoutant à sa phrase un « vous me comprenez ? » qui corrige complètement ce qu’elle pourrait avoir de mystique.
Le soir du 31 décembre au même bar de la rue Xavier-Privas, les lettristes trouvent K. et les habitués terrorisés — malgré leurs habitudes de violence — par une sorte de bande, forte d’une dizaine d’Algériens venus de Pigalle, et qui occupent les lieux. L’histoire, des plus obscures, semble concerner à la fois une affaire de fausse monnaie et les rapports qu’elle pourrait avoir avec l’arrestation dans ce bar même, quelques semaines auparavant, d’un ami de K., pour trafic de stupéfiants. Comme il est apparent que le premier désir des visiteurs est de ne pas mêler des Européens à un règlement de comptes qui, entre Nord-Africains, n’éveillera pas grande attention de la police, et comme K. leur demande instamment de ne pas sortir du bar, G.D. et G.I. passent la nuit à boire au comptoir (où les visiteurs ont placé une fille amenée par eux) parlant sans arrêt et très haut, devant un public silencieux, de manière à aggraver encore l’inquiétude générale. Par exemple, peu avant minuit, sur la question de savoir qui doit mourir cette année ou l’année prochaine ; ou bien en évoquant le mot du condamné exécuté à l’aube d’un premier janvier : « Voilà une année qui commence bien » ; et toutes les boutades de ce genre qui font blêmir la quasi-totalité des antagonistes. Même vers le matin, G.D. étant ivre-mort, G.I. continue seul pendant quelques heures, avec un succès toujours aussi marqué. La journée du 1er janvier 1954 se passe dans les mêmes conditions, les multiples manœuvres d’intimidation et les menaces voilées ne persuadant pas les deux lettristes de partir avant la rixe, et eux-mêmes n’arrivant à joindre aucun de leurs amis par le téléphone dont ils n’ont pu s’emparer qu’en payant d’audace. Enfin, aux approches du soir, les amis de K. et les étrangers arrivent à un compromis et se quittent de mauvaise grâce (K. par la suite éludera avec crainte toute explication de cette affaire, et les lettristes jugeront discret d’y faire à peine allusion).
Le lendemain, vers la fin de l’après-midi, G.D. et G.I., s’apercevant soudain qu’ils sont près de la rue Vieille du Temple, décident d’aller revoir un bar de cette rue où, six semaines plus tôt, G.I. avait noté quelque chose de surprenant : comme il y entrait, au cours d’une dérive en compagnie de P[atrick] S[traram], le barman, manifestant une certaine émotion à sa vue, lui avait demandé « Vous venez sans doute pour un verre ? » et, sur sa réponse affirmative, avait continué « Il n’y en a plus, revenez demain ». G.I. avait alors machinalement répondu « C’est bien », et était sorti ; et P.S., quoique étonné d’une réaction si absurde, l’avait suivi.

L’entrée de G.I. et G.D. dans le bar fait taire à l’instant une dizaine d’hommes qui parlaient en yiddish, assis à deux ou trois tables, et tous coiffés de chapeaux. Alors que les lettristes boivent quelques verres d’alcool au comptoir, tournant le dos à la porte, un homme, également coiffé d’un chapeau, entre en courant, et la serveuse — qu’ils n’ont jamais vue — leur fait signe de la tête que c’est à lui qu’ils doivent s’adresser. L’homme apporte une chaise à un mètre d’eux, s’asseoit, et leur parle à très haute voix, et fort longtemps, en yiddish, sur un ton tantôt convaincant et tantôt menaçant mais sans agressivité délibérée, et surtout sans avoir l’air d’imaginer qu’ils puissent ne rien comprendre. Les lettristes restent impassibles ; regardant avec le maximum d’insolence les individus présents qui, tous, semblent attendre leur réponse avec quelque angoisse ; puis finissent par sortir. Dehors, ils s’accordent pour constater qu’ils n’ont jamais vu une ambiance aussi glaciale, et que les gangsters de la veille étaient des agneaux en comparaison. Dérivant encore un peu plus loin, ils arrivent au pont Notre-Dame quand ils s’avisent qu’ils sont suivis par deux des hommes du bar, dans la tradition des films de gangsters. C’est à cette tradition qu’ils croient devoir s’en remettre pour les dépister, en traversant le pont négligemment, puis en descendant brusquement à droite sur le quai de l’île de la Cité qu’ils suivent en courant, passant sous le Pont-Neuf, jusqu’au square du Vert-Galant. Là, ils remontent sur la place du Pont-Neuf par l’escalier dissimulé derrière la statue d’Henri IV. Devant la statue, deux autres hommes en chapeaux qui arrivaient en courant — sans doute pour surplomber la berge du quai des Orfèvres, qui paraît la seule issue quand on ignore l’existence de cet escalier — s’arrêtent tout net en les voyant surgir. Les deux lettristes marchent vers eux et les croisent sans que, dans leur surprise, ils fassent un seul geste ; puis suivent le trottoir du Pont-Neuf vers la rive droite. Ils voient alors que les deux hommes se remettent à les suivre ; et il semble qu’une voiture engagée sur le Pont-Neuf, avec laquelle ces hommes paraissent échanger des signes, se joigne à la poursuite. G.I. et G.D. traversent alors le quai du Louvre au moment précis où le passage est donné aux voitures, dont la circulation en cet endroit est fort dense. Puis, mettant à profit cette avance, ils traversent en hâte le rez-de-chaussée du grand magasin « La Samaritaine », sortent rue de Rivoli pour s’engouffrer dans le métro « Louvre », et changent au Châtelet. Les quelques voyageurs munis de chapeaux leur paraissent suspects. G.I. se persuade qu’un Antillais, qui se trouve près de lui, lui a fait un signe d’intelligence, et veut y voir un émissaire de J., chargé de les soutenir contre ce surprenant déchaînement de forces contraires. Descendus à « Monge », les lettristes gagnent la Montagne-Geneviève à travers le Continent Contrescarpe désert, où la nuit tombe, dans une atmosphère d’inquiétude grandissante.

II. Relevé d’ambiances urbaines au moyen de la dérive

Le mardi 6 mars 1956, G.-E. Debord et Gil J Wolman se rencontrent à 10 h. dans la rue des Jardins-Paul, et partent en direction du nord pour reconnaître les possibilités d’une traversée de Paris à ce niveau. Malgré leurs intentions ils se trouvent rapidement déportés vers l’est et traversent la partie supérieure du XIe arrondissement qui, par son caractère de standardisation commerciale pauvre, est un bon exemple du paysage petit-bourgeois repoussant. La seule rencontre plaisante est, au 160 de la rue Oberkampf, le magasin « Charcuterie-Comestibles A. Breton ». Parvenus dans le XXe arrondissement Debord et Wolman s’engagent dans une série de passages étroits qui, à travers des terrains vagues et des constructions peu élevées qui ont un grand air d’abandon, joignent la rue de Ménilmontant à la rue des Couronnes. Au nord de la rue des Couronnes, ils accèdent par un escalier à un système de ruelles du même genre, mais déprécié par un fâcheux caractère pittoresque. Leur progression se trouve ensuite infléchie vere le nord-ouest. Ils traversent, entre l’avenue Simon-Bolivar et l’avenue Mathurin-Moreau, une butte où s’enchevêtrent des rues vides, d’une consternante monotonie de façade (rues Rémy-de-Gourmont, Edgar-Poë, etc.). Peu après, ils en viennent à surgir à l’extrémité du canal Martin, et rencontrent à l’improviste l’admirable rotonde de Claude-Nicolas Ledoux, presque ruinée, laissée dans un incroyable abandon, et dont le charme s’accroît singulièrement du passage, à très proche distance, de la courbe du métro suspendu. On songe ici à l’heureuse prévision du maréchal Toukhachevsky, citée jadis dans La Révolution Surréaliste, sur la beauté que gagnerait Versailles quand une usine serait construite entre le château et la pièce d’eau.

En étudiant le terrain, les lettristes croient pouvoir conclure à l’existence d’une importante plaque tournante psychogéographique — la rotonde de Ledoux en occupant le centre — qui peut se définir comme une unité Jaurès-Stalingrad, ouverte sur au moins quatre pentes psychogéographiques notables (canal Martin, boulevard de la Chapelle, rue d’Aubervilliers, canal de l’Ourcq), et probablement davantage. Wolman rappelle à propos de cette notion de plaque tournante le carrefour qu’il désignait à Cannes, en 1952, comme étant « le centre du monde ». Il faut sans doute en rapprocher l’attirance nettement psychogéographique de ces illustrations, pour les livres des très jeunes écoliers, où une intention didactique fait réunir sur une seule image un port, une montagne, un isthme, une forêt, un fleuve, une digue, un cap, un pont, un navire, un archipel. Les images des ports de Claude Lorrain ne sont pas sans parenté avec ce procédé.
C’est par la belle et tragique rue d’Aubervilliers que Debord et Wolman continuent à marcher vers le nord. Ils y déjeunent au passage. Ayant emprunté le boulevard Macdonald jusqu’au canal Denis, ils suivent la rive droite de ce canal vers le nord, stationnant plus ou moins longuement dans divers bars de mariniers. Immédiatement au nord du pont du Landy, ils passent le canal à une écluse qu’ils connaissent et arrivent à 18 h 30 dans un bar espagnol couramment nommé par les ouvriers qui le fréquentent « Taverne des Révoltés », à la pointe la plus occidentale d’Aubervilliers, face au lieudit La Plaine, qui fait partie de la commune de Denis. Ayant repassé l’écluse, ils errent encore un certain temps dans Aubervilliers, qu’ils ont parcouru des dizaines de fois la nuit, mais qu’ils ignorent au jour. L’obscurité venant, ils décident enfin d’arrêter là cette dérive, jugée peu intéressante en elle-même.
Faisant la critique de l’opération, ils constatent qu’une dérive partant du même point doit plutôt prendre la direction nord-nord-ouest ; que le nombre des dérives systématiques de ce genre doit être multiplié, Paris leur étant encore, dans cette optique, en grande partie inconnu ; que la contradiction que la dérive implique entre le hasard et le choix conscient se reconduit à des niveaux d’équilibre successifs, et que ce développement est illimité. Pour le programme des prochaines dérives Debord propose la liaison directe du centre Jaurès-Stalingrad (ou Centre Ledoux) à la Seine, et l’expérimentation de ses débouchés vers l’ouest. Wolman propose une dérive qui, à partir de la « Taverne des Révoltés », suivrait le canal vers le nord, jusqu’à Denis et au-delà.